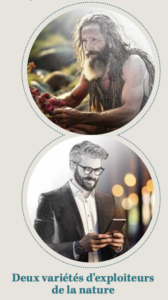La troisième guerre mondiale est reportée à une date indéterminée ; quant à la mondialisation, elle a sans doute rendu l’âme ce 20 janvier 2025. Il reste à savoir si le nouvel âge d’or des États-Unis va bien se confirmer, malgré l’affirmation péremptoire de son quarante-septième Président.
Dans un Washington enneigé et venteux, aux températures polaires, la cérémonie d’investiture de Donald Trump a dû se réfugier à l’intérieur du Capitole. En 1985 aussi, l’investiture du président Ronald Reagan avait été déplacée intra-muros pour raisons climatiques extrêmes. Mais on peut se demander si des raisons de sécurité n’ont pas concouru également à ce déménagement. La capitale américaine était en tout cas sous haute surveillance. Plus de 25.000 policiers et militaires de la garde nationale avaient été convoqués pour assurer la sécurité de l’événement.
Devant un parterre de personnalités du monde politique américain ou étranger — dont la première ministre italienne Giorgia Meloni, le président argentin Javier Milei et le premier ministre hongrois Viktor Orbán —, du monde des affaires — dont plusieurs CEO des GAFAM (Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et l’inévitable Elon Musk) —, Donald Trump a donc prêté serment pour la deuxième fois.
Le plus frappant dans la cérémonie était d’observer, à proximité immédiate du nouveau président, ses prédécesseurs et adversaires, le visage fermé et s’abstenant d’applaudir, au contraire de la salle. Un Joe Biden absent comme à son habitude, un George W. Bush qui semblait terrorisé, un Barack Obama célibataire et une Hillary Clinton soit figée dans un rictus, soit les yeux au plafond, sans oublier sa concurrente aux dernières élections, la transparente Kamala Harris qui ne s’est apparemment pas encore remise de sa cinglante défaite.
Trump impérial, au sommet de son charisme, devait certainement savourer son triomphe implacable. Il est vrai qu’il dispose, au moins pour deux ans jusqu’aux mid-terms, d’une opportunité sans précédent de dérouler son programme. Après avoir gagné le vote populaire1, confirmant l’énorme courant de sympathie qu’il draine au sein du peuple américain, il peut aussi s’appuyer sur une Chambre des Représentants et un Sénat à majorité républicaine. Sans oublier une Cour Suprême acquise à sa cause.
L’immense vague rouge2 qui déferle sur les États-Unis doit lui permettre de démarrer un nouveau mandat sur les chapeaux de roues. Ce que sa première mandature ne lui avait pas permis de réaliser, suite notamment aux multiples entraves mises par les démocrates et l’État profond (procédures de destitution, accusations de collusion avec la Russie, virulente campagne systématique et permanente de dénigrement de la presse mainstream, etc.), ce retour à la Maison blanche va probablement se concrétiser par un virage total de la politique étatsunienne, tant sur le plan intérieur qu’extérieur.
La politique étrangère de Trump devra d’ailleurs se comprendre à l’aune de sa politique nationale. La neutralisation des foyers de conflits comme l’Ukraine ou le Proche ou Moyen-Orient s’explique par sa volonté de redéployer tous les moyens mis à sa disposition vers la patrie. Ramener les « boys » à la maison, mettre un terme au « Project for the New American Century » des néo-conservateurs, axe central de l’expansionnisme guerrier, agressif et brutal des États-Unis, dans un monde post-guerre froide, transformant une superpuissance en une hyperpuissance hégémonique, réorienter les moyens budgétaires vers les politiques nationales, tel est la mission à laquelle il va se consacrer durant ces quatre prochaines années. Comme le disait Benjamin Franklin3 : « Un peuple vertueux et assidu peut être gouverné à peu de frais… Le système de l’Amérique est le commerce avec tous et la guerre avec personne ». Cette sentence coïncide à merveille avec la conception « trumpienne » de la présidence.
Les figures tutélaires de Trump
Mais Donald Trump semble à l’évidence particulièrement inspiré aussi par deux autres illustres prédécesseurs à Washington : Andrew Jackson, 7ème président des États-Unis, de 1829 à 1837 et James Monroe, 5ème président de 1817 à 1825. Lorsqu’il avait gagné la présidentielle de 2016, il avait fait installer dans le bureau ovale le portrait d’Andrew Jackson qu’il admire. Proche du peuple, c’est le premier président des États-Unis d’extraction modeste. Jackson ne supportait pas les politiciens professionnels et les institutions qui tendent à acquérir un pouvoir indépendant. Il est tenu pour être l’initiateur d’une spécificité politique étatsunienne : le « spoils system »4. En 1828, il fait campagne contre John Quincy Adams5 en fustigeant la corruption de l’administration. Une fois élu, il entreprend donc de « nettoyer les écuries d’Augias » en licenciant tous les hauts fonctionnaires qui avaient entouré le président sortant pour les remplacer par des hommes de son entourage.
l’organisation des États-Unis que propose Donald Trump est complètement différente de celle des Démocrates ou des Républicains classiques. Il veut redonner le pouvoir aux États. C’est pour cela que des centaines d’agences gouvernementales seront démantelées. Il ne fait pas cela parce qu’il serait libertarien, mais bien parce qu’il est un « jacksonien ». Souvenons-nous du débat sur l’avortement. Trump a soutenu la Cour Suprême dans sa décision de sortir le droit à l’avortement du droit constitutionnel, soit de le transférer du domaine fédéral aux États6. Nombreux furent les médias et les militants de gauche à hurler contre lui, prétendant qu’il était opposé à l’avortement, alors qu’il s’agissait juste d’un transfert de compétence du fédéral vers les États, sachant que certains de ceux-ci sont certes majoritairement conservateurs, mais d’autres largement libéraux7, donc où les avortements se pratiquent librement.
Le second personnage historique qui a influencé l’homme d’affaires new-yorkais est sans conteste, James Monroe, père de la doctrine qui porte son nom. Ce corpus idéologique doit être considéré comme un des piliers de politique étrangère des États-Unis. Il constitue véritablement l’ADN de la Grande République. Or, l’isolationnisme américain a été réduit à portion congrue dès l’entrée en guerre du pays dans le premier conflit mondial et pratiquement abandonné après l’attaque de Pearl Harbor par le Japon en 1941.
Cette question est d’une importance extrême et sa dimension historique permet de se rendre compte du revirement fondamental qu’entreprend Donald Trump. Le président retourne aux fondamentaux du pays de l’Oncle Sam.
Au tournant du XXe siècle, la puissance industrielle américaine supplante les États européens. À l’issue de la Première Guerre mondiale, les États-Unis remplacent le Royaume-Uni comme puissance hégémonique. L’ancien ordre mondial britannique fait place au Nouvel Ordre Mondial américain. Londres fait place à New-York comme centre du monde. Cette prospérité économique voit l’émergence d’une classe dirigeante capitalistique dont la richesse n’a d’égale que son influence décisionnelle. La classe politique est totalement sous la férule de ces puissants patrons d’industries. Cornelius Vanderbilt , John D. Rockefeller , Andrew Carnegie , J. P. Morgan et Henry Ford, et autres milliardaires ont véritablement bâti l’Amérique. Ils vont imposer leurs vues tant sur le développement du pays, ses infrastructures routières, ferroviaires, portuaires que sur la politique expansionniste. Le leadership américain ne peut se comprendre sans cette soif absolue de conquête, d’enrichissement, de maximalisation des profits. Les banquiers de Wall Street qui prennent ensuite le relais, en transformant le capitalisme industriel en capitalisme financier vont étendre leur mainmise sur l’ensemble de la planète. La Deuxième Guerre mondiale servant véritablement de rampe de lancement de leur hégémonie sur les cinq continents.
Le grand historien anglo-américain Antony Sutton a remarquablement décrit avec force détails le financement de la Russie bolchevique par Wall Street et ses partenaires européens8. Soutien qui se prolongea durant toute l’existence de l’URSS. Pour le plus grand bonheur du complexe militaro-industriel américain, disposer d’un « meilleur ennemi » pareil, particulièrement durant la guerre froide, fut une suprême félicité. La réindustrialisation de l’Allemagne dans les années 1920 et la remilitarisation qui suivit, avec la montée au pouvoir d’Adolf Hitler, sont également à mettre au crédit de ses banquiers rapaces qui n’avaient comme seules considérations que l’appât du gain9. En outre, que les régimes soient communistes, socialistes ou national-socialiste, ils ont en commun le besoin d’un État fort, donc des dépenses publiques importantes, donc des besoins de financement importants et de la création de dettes. Ce que les banquiers apprécient tout particulièrement.
Dans les années d’après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis devenus les gendarmes du monde vont multiplier les guerres (Corée, Vietnam, Moyen-Orient, etc.) les conflits, les coups d’État, soutenir des dictatures au nom de la démocratie libérale et même, hypocrisie suprême, de la défense des droits de l’homme. Dwight David Eisenhower, 34ème président, dans son fameux discours de fin de mandat, le 17 janvier 1961, mettra en garde son pays contre la montée en puissance d’un « complexe militaro-industriel »10. Son successeur, John Fitzgerald Kennedy, fera de même en prononçant aussi un discours le 27 avril 1961 dans lequel il dénonce la « conspiration monolithique et impitoyable », soit l’État profond américain11.
Des patriotes dans l’armée US
Une hypothèse s’est développée ces dernières années, qui tend à identifier, au sein du Pentagone (le département de la Défense), un groupe de militaires particulièrement inquiets de la tournure des événements après l’assassinat à Dallas de JFK le 22 novembre 1963, et partageant de forts sentiments patriotiques. Ce groupe fonctionnant de manière totalement secrète s’est progressivement renforcé au sein du Deep State états-unien pour acquérir une force suffisante afin de contrecarrer les plans bellicistes de ce dernier. On peut considérer cette hypothèse comme pure spéculation, cependant de nombreux éléments, au fil du temps, viennent la corroborer. Vers 2010, à de multiples reprises, le va-t-en-guerre Barack Obama12 a été confronté à une véritable fronde des officiers, notamment lors de l’affaire du nucléaire iranien. En autorisant l’Iran à développer un arsenal nucléaire, Obama cherchait à créer un casus belli qui conduirait probablement à une Troisième Guerre mondiale. Plusieurs hauts gradés comme le général du corps des Marines James Mattis ou Mike Flynn, directeur de la Defense Intelligence Agency (renseignement militaire étranger), furent renvoyés ou donnèrent leur démission.
Wikileaks avait aussi, de son côté, révélé de nombreux scandales comme les crimes de guerre commis par les USA en Irak et en Afghanistan, et le financement des groupes terroristes islamiques comme Al-Qaïda ou Daech.
Ce groupe de militaires patriotes était face à deux choix : soit lancer un coup d’État militaire, soit utiliser le processus électoral normal. Pour éviter trop de risques et des pertes humaines éventuelles, ils optèrent pour la seconde solution. Il se mit à la recherche d’un candidat potentiel pour l’élection présidentielle de 2016. Un candidat « inoxydable », paré à répondre à tous les coups, qui partage la même vénération pour la mère patrie. Un candidat hors système, loin du marigot washingtonien et dont l’indépendance financière l’éloigne des compromissions et de la corruption à laquelle la caste politicienne est tellement sujette. Donald Trump représentait le candidat idéal.
Deux faits marquants vont le distinguer du reste de la caste des businessmen américains. En septembre 1987, il achète dans plusieurs grands journaux une page de publicité pour publier une « lettre ouverte » adressée « au peuple américain », dans laquelle il prône une politique isolationniste pour relancer l’économie des États-Unis. Le 11 septembre 2001, Trump est interviewé par une chaîne locale, WWOR, peu de temps après les attentats. Pendant dix minutes, celui qui n’était encore « que » milliardaire raconte comment il a observé la chute des deux gratte-ciel, quelques instants plus tôt. « J’ai une fenêtre qui donne directement sur le World Trade Center et j’ai vu cette énorme explosion. J’étais avec un groupe de personnes. Je n’arrivais pas à y croire », racontait le magnat. « Maintenant, je ne vois absolument rien. Il a tout simplement disparu. C’est difficile à croire », ajoutait Trump. Cette vidéo a été effacée et il n’en reste aucune trace.
Mais la patte indéniable de Donald Trump, c’est son talent absolu de la négociation. L’auteur du best-seller The Art of the Deal13, est un négociateur né. Il sait qu’au début de la discussion, il faut toujours avancer des revendications maximalistes. Car, au fil du temps, il faudra faire des compromis et réduire ses prétentions. Cette technique de vente s’appelle l’hyperbole véridique, une manière de tordre de réel et d’exagérer, pour revenir ensuite à des propositions plus réalistes. C’est ainsi qu’il faut comprendre ses projets de tarification douanière avec la Chine, l’Europe ou avec ses voisins canadiens et mexicains. Ni plus ni moins.
Un candidat inoxydable
Le choix de Trump par les officiers patriotes tient donc aussi à sa personnalité. C’est un homme d’affaires expérimenté qui a fait fortune à New York, où le monde des affaires est particulièrement rude et sans pitié. Nous ne sommes pas à Chaumont-Gistoux ou Oupeye ! Durant sa carrière, il a été confronté certainement à des gens peu recommandables, à la mafia italienne et juive. Il a été choisi aussi pour cela. Il a le cuir bien ferme et une capacité de résistance à tous les mauvais coups. Sa résilience est forte. N’oublions que son mentor et père spirituel est l’avocat Roy Cohn. Ce dernier a connu la notoriété dans les années 1950, au côté du sénateur Mc Carthy, célèbre pour ses campagnes de dénigrement contre les « ennemis de l’intérieur », particulièrement les personnes affiliées ou supposées affiliées au parti communiste. Cohn était à ses côtés notamment lors du fameux procès contre les Rosenberg. Dans les années 1970, il a été le conseil du père de Donald Trump. Puis de son fils. D. Trump dit de lui : « Si vous avez besoin de quelqu’un qui peut devenir brutal contre vos opposants, vous faites appel à Roy. » Conseiller juridique de nombreuses personnalités new-yorkaises, finalement devenu un membre actif de la vie mondaine de la ville, il usait de méthodes très critiquées pour attaquer les adversaires de ses clients, se concentrant pour les détruire psychologiquement et systématiquement contre-attaquer en les accusant. L’auteur Sam Roberts résume ainsi sa stratégie :
« Premièrement, ne transigez jamais, n’abandonnez jamais ; deuxièmement, contre-attaquez immédiatement ; troisièmement, peu importe ce qui arrive, peu importe à quel point vous êtes dans la mouise, revendiquez toujours la victoire. »
En 2015, un an avant la présidentielle, plusieurs officiers, dont le chef d’État-major des armées des États-Unis, le général Joseph Dunford, sont allés rencontrer Donald Trump pour lui demander d’être le visage public de cette reconquête des institutions publiques du pays14. Trump accepta donc le défi, moyennant des garanties en matière de sécurité pour sa famille. Ces militaires rebelles à Obama se retrouveront ensuite dans l’équipe mise en place par Trump à la Maison-Blanche. Michael S. Rogers, directeur de la National Security Agency (NSA), informera Trump, immédiatement après sa victoire électorale de 2016 qu’il avait été mis sous écoute par Barack Obama15.
Premier mandat
Il va sans dire que le premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche fut loin d’être une sinécure. Tout ne doit cependant pas être mis sur le dos des démocrates ou des fonctionnaires de l’État profond étatsunien. Certes, ceux-ci n’ont pas arrêté de savonner la planche sur laquelle était installé Trump, mais celui-ci était sans doute inexpérimenté et mal entouré d’experts et de conseillers, qui pour certains se sont avérés de véritables infiltrés du camp d’en face. Les défis auxquels Donald Trump était confronté sont à la fois structurels et liés à des oppositions politiques particulièrement intenses et vindicatives. L’Impeachment, même sans condamnation16, a été un coup dur pour sa présidence. Ses projets comme la modernisation du système routier américain ou la construction du mur à la frontière mexicaine n’ont pas abouti comme il le souhaitait. Sa promesse d’abolir l’Affordable Care Act (Obamacare)17 a subi le blocage du Congrès et la loi n’a pas pu être remplacée par un autre règlement. Cependant, si on doit retenir un seul échec de ces quatre années de présidence, il faut davantage retenir sa gestion de la dette américaine qui n’a cessé de croître. Sa réforme fiscale de 2017 a même causé une augmentation significative de celle-ci.
Parmi les succès qu’il a pu néanmoins dégager, il faut acter sa politique économique qui a permis la création de plusieurs milliers d’emplois. l’économie américaine a connu, sous le premier mandat de Trump, une période de croissance soutenue, avec un taux de chômage historiquement bas, notamment pour les minorités. Sur le plan judiciaire, la signature du First Step Act en 2018 est vue comme une avancée notable. Cette loi a introduit des réformes visant à réduire les peines pour certains délits, à améliorer les conditions de détention et à faciliter la réintégration des détenus. Toujours sur le plan intérieur, l’administration Trump a favorisé la production d’énergie domestique, notamment le pétrole et le gaz naturel, en assouplissant les régulations environnementales. Cela a conduit à une indépendance énergétique accrue pour les États-Unis.
Au niveau de ses réussites sur le plan international, Trump a incontestablement repositionné les États-Unis sur la scène mondiale avec une approche moins interventionniste. Mais les « Accords d’Abraham » représentent une avancée diplomatique importante au Moyen-Orient. C’est sous son administration que des accords de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes (Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan, et Maroc) ont pu être signés. Gageons que ces résultats vont probablement constituer les fondements et les orientations de sa stratégie internationale pour les quatre ans à venir.
Nous n’allons pas nous étendre sur la lamentable élection présidentielle de 2020, qui représente une tache sombre dans l’histoire politique américaine, tant la fraude électorale massive correspond plus aux pratiques d’une république bananière corrompue qu’à celles d’un des grands états prétendus démocratiques du monde18. Nous ne reviendrons pas non plus sur la présidence de Joe Biden, dont on pouvait se rendre compte par une observation rapide de son comportement, déjà lors de la campagne électorale, qu’il ne disposait pas des facultés cognitives et de toute la lucidité pour assurer raisonnablement son mandat. On doit plutôt parler d’une administration Biden qui géra collectivement le pays avec des décisionnaires non élus, qui opéraient derrière le rideau. Les instances du parti démocrate et ses « stars » dont Obama et le couple Clinton font probablement partie du casting.
Bernard Van Damme