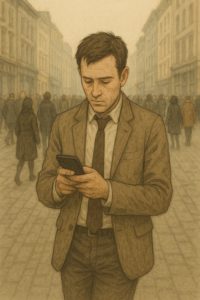« La langue ne se contente pas seulement de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral d’autant plus naturellement que je m’en remets inconsciemment à elle. Et qu’arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d’éléments toxiques ou si l’on en a fait le vecteur de substances toxiques ? Les mots peuvent être comme des minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir »Viktor Klemperer(1)
La Novlangue est connue comme le dialecte des habitants d’Oceania, pays totalitaire imaginé par l’écrivain George Orwell dans son roman 1984. Son principe est élémentaire : travestir le sens des mots et simplifier la langue afin d’asseoir la domination du régime sur l’ensemble des couches de la société. Plus ce procédé est appliqué, plus le langage s’appauvrit. Les gens devienne …
Vous devez être abonné pour visualiser cette page.
Si vous êtes déjà abonné, veuillez-vous connecter.
Dans le cas contraire, abonnez-vous dès à présent.
Si vous êtes déjà abonné, veuillez-vous connecter.
Dans le cas contraire, abonnez-vous dès à présent.
Notes et références
- Philologue juif ayant notamment écrit LTI : la langue du 3ème Reich, 1947.
- Plus inquiétant peut-être : nous pouvons en réalité écrire les analyses les plus pertinentes dans l’indifférence la plus totale.
- Voir notre article paru dans le 64ème numéro de Kairos : « Démocratie représentative : le berceau d’un oxymore ».
- Voir Guy Debord.
- À y regarder de plus près en effet, la fable reprise par Pierre Rabhi ne respire pas l’humilité, mais est pétrie de condescendance ; le petit colibri auquel l’individu est invité à s’identifier vole ainsi fièrement et vaillamment à contre-courant de tous ces idiots d’animaux figés par la peur. Sous ces grands airs, le petit oiseau souffre en réalité d’un manque de reconnaissance, ce qui l’amène à agir sans le groupe. Nous en voulons pour preuve qu’il ne prendra pas la peine de se concerter avec ses comparses afin de mener l’action la plus adéquate qui soit, ni même de raisonner – pour peu que ceci soit son objectif – ses compagnons autrement que par l’agir. Culotté, il se permet de plus d’endosser le costume du moralisateur par l’énonciation d’une phrase laconique et assassine – « Je le sais, mais je fais ma part » (et toc !) – à celui-là seul (le tatou) qui tente de discuter, d’échanger de la parole, c’est-à-dire de tisser du lien avec lui. Le tatou n’a peut-être pas totalement tort d’attirer le colibri vers la conscientisation de sa propre folie ; si celui-ci s’agite pour faire sa part, ce n’est finalement pas tant pour éteindre le feu que dans le but de raviver un narcissisme grièvement étiolé sous les effets de la postmodernité.
- Clin d’œil à la désormais célèbre rubrique d’Alain Adriaens qui paraît dans ces colonnes.
- Voir les deux principes catégoriques d’Emmanuel Kant.
- Voir l’œuvre de Dany-Robert Dufour.
- Voir Jacques Ellul, La métamorphose du bourgeois.
- Ceci a été fait dans le numéro 63 de Kairos au travers de notre article « Psychanalyse de l’EVRAS ».
- Voir notre article paru dans le 44ème numéro de L’escargot déchaîné : Penser la crise. Le dixième discours paradoxal : une gestion libérale de la pandémie.