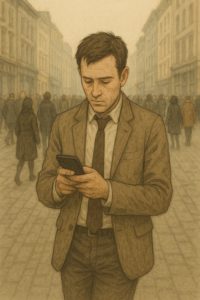Une momie et une potiche
Outre ses trahisons à la lettre de la Constitution américaine, ces autres années ont été marquées par une politique migratoire complaisante qui créa un inquiétant appel d’air à la frontière sud des États-Unis, dans lequel s’est engouffrée toute une série d’organisations criminelles (traite d’êtres humains, trafiquants d’enfants, narcotrafiquants, etc.), une politique internationale dans la droite continuité du bellicisme néoconservateur, mais ne disposant plus des moyens passés. Le retrait d’Afghanistan s’est déroulé dans un chaos immense, aggravé par le retour rapide des Talibans au pouvoir à Kaboul.
Sur le plan intérieur, la gestion économique de l’administration Biden s’est soldée par une inflation galopante qui a particulièrement affecté les plus démunis. La promotion très idéologique et très peu pragmatique des énergies renouvelables1, la réduction de la production nationale de pétrole et de gaz, due à des politiques environnementales trop restrictives, ont contribué à une augmentation des coûts de l’énergie pour les consommateurs et pour les entreprises.
La perte du pouvoir d’achat et le soutien à des politiques wokistes qui fragilisent les fondamentaux culturels d’une majorité des Américains sont sans doute les deux raisons du rejet des démocrates dans l’opposition. Après que Biden ait jeté l’éponge suite à un débat catastrophique à la télévision, la candidature de Kamala Harris, la vice-présidente, sans passer par le processus traditionnel des primaires, allait s’avérer être le pire choix de toute l’histoire du parti démocrate. Fuyant les directs, les interviews où les questions ne sont pas communiquées à l’avance, multipliant les gaffes et les postures affligeantes, cherchant le soutien d’un showbizz totalement hermétique aux problèmes quotidiens des citoyens américains — qui ne peuvent plus supporter l’arrogance et leurs vies dépravées étalées dans les médias et les réseaux sociaux —, il devenait de plus en plus clair que Harris allait se faire dévorer tout crue par Donald Trump. Sa victoire écrasante atteste de la déconnexion complète du parti démocrate avec une majorité du peuple américain.
Au-delà des acteurs qui participent à ces joutes électorales, attardons-nous un instant sur les mouvements sociologiques de fond qui permettent de comprendre les résultats de l’élection de 2024. Les États-Unis subissent une fracture importante au sein de sa population. Elle explique la victoire d’une des deux grandes forces politiques sur l’autre.
La fracture de la société américaine
Les Républicains renouent avec le réalisme politique, un courant que nous pouvons qualifier de vitaliste. Alors que les Démocrates représentent aujourd’hui une tendance culturaliste régressive, qui n’est pas sans rappeler l’idéologie de la social-démocratie européenne (qui s’étend d’ailleurs bien au-delà des seuls partis socialistes et recouvre même la droite conservatrice modérée). Ça n’a pas toujours été le cas. Auparavant, le parti républicain était considéré comme le parti de la bourgeoisie, alors que le parti démocrate représentait les classes laborieuses, les ouvriers des grandes villes industrielles comme Chicago ou Détroit.
Durant ces 50 dernières années, les démocrates ont basculé d’une approche que nous pourrions presque étiqueter de marxiste à une tendance intellectualiste. Il ne s’adresse plus quasiment qu’aux intellectuels et aux universitaires. L’influence des campus est indéniable au sein du camp démocrate. Par conséquent, il est parfaitement logique que la pensée dominante au sein des universités américaines représentée par le structuralisme, que les Américains appellent aussi la « French Theory », ait percolé au sein du courant démocrate. Il n’est pas étonnant que les politiciens de gauche préfèrent passer leurs temps à critiquer plutôt qu’à élaborer des stratégies. La pensée progressiste est devenue tellement critique qu’elle remet en question la réalité naturelle, la reproduction, etc., en somme, la vie en tant que telle, jusqu’à s’acheminer vers le transhumanisme.
La déconstruction, qui tient une place centrale dans les théories structuralistes en vogue dans les milieux universitaires américains a servi de repoussoir pour bon nombre de citoyens, qui ne se retrouvent pas dans ce courant de pensée. Il faut se rappeler que les États-Unis se sont bâtis sur le puritanisme que les colons britanniques ont emporté dans leurs bagages. La bible représentait pour eux une sorte de constitution qui leur a permis de se structurer politiquement. La tendance wokiste, bien que tenue en marge du parti démocrate, représente néanmoins un courant bruyant et anxiogène pour beaucoup d’Américains. Il n’est dès lors pas étonnant que des personnalités comme Tulsi Gabbard ou Robert F. Kennedy Jr, qui ont rejoint en cours de campagne Donald Trump, proviennent du parti démocrate. La vision démocrate qui est la leur est celle du parti des années 1960–70, qu’ils retrouvent en fait au sein du parti républicain actuel. On peut considérer qu’une partie de la nouvelle administration Trump comme « paléo-démocrate ».
Une partie majoritaire de la population reste attachée à la culture de liberté et de responsabilité propre à l’Amérique. Les Républicains, en devenant le parti des travailleurs, ont pu agréger ces différentes tendances pour s’opposer au wokisme, considéré comme un phénomène régressif. C’est le sens du vote pour Donald Trump. Il s’ajoute à cela la volonté affirmée par ses électeurs de s’occuper enfin des vrais problèmes comme la perte du pouvoir d’achat, liée à l’inflation et l’augmentation du prix de l’essence. Face à la politique instable, aventureuse de l’administration Biden, Trump est apparu comme un modérateur qui rassemble le peuple américain sur ses valeurs fondamentales. Sa tendance isolationniste au niveau de sa politique étrangère correspond aussi à l’ADN véritable de la république étatsunienne.
En qualifiant les électeurs de Trump de pitoyables, Hillary Clinton se rendait-elle compte, lors de la campagne pour les présidentielles de 2016, qu’elle se tirait une balle dans le pied ? Le mépris, la morgue des intellectuels de gauche qui considèrent l’électorat « Maga2 » comme une bande de rednecks3 armés jusqu’aux dents, ou de fondamentalistes religieux, ont également heurté les classes moyennes, qui commencent aussi à souffrir du déclassement social. Cette caricature grossière, reprise par la presse dominante européenne dénote aussi de la cécité et du recul cognitif inquiétant de ces supposés relais de l’information. Bien sûr, Trump joue aussi ce rôle de composition populiste, parfois brutal, fait de rodomontades, de bluff, de retournement d’opinion à 180°. Il arrive ainsi à manipuler l’opinion et surtout les médias qui tombent systématiquement dans le panneau. Mais ces choix tactiques ne doivent pas faire oublier sa ligne de conduite, qui elle, est très stable et solide, ancrée dans son patriotisme sincère et profond, presque viscéral
Le come-back de Trump
Parfaitement instruit de sa première expérience à la Maison-Blanche, son nouveau mandat, qui démarre sur les chapeaux de roues, sera incontestablement très différent. On peut en avoir l’augure par l’équipe extrêmement expérimentée de laquelle il s’entoure. Des personnalités très éloignées du microcosme washingtonien comme Elon Musk, le milliardaire, patron de Tesla et Space X, qui va mener tambour battant des réformes structurelles dans l’administration, en s’inspirant de ses propres modes de gestion du personnel. J.D. Vance, son vice-président, un fils de la Rust Belt4, qui allie de profondes idées conservatrices à des conceptions très libertariennes de la gestion financière. Marco Rubio, son secrétaire d’État (ministre des Affaires étrangères), politicien expérimenté aux positions fermes sur la Chine et l’Iran. Pete Hegseth, son secrétaire à la Défense. Ancien soldat ayant servi en Irak et en Afghanistan, qui va cette fois batailler contre le complexe militaro-industriel et nettoyer le Pentagone.Matt Gaetz, son procureur général (ministre de la Justice), représentant républicain de Floride, un loyal parmi les loyaux dans l’entourage de Trump.L’ancienne députée démocrate Tulsi Gabbard, particulièrement investie dans le dossier des laboratoires biologiques en Ukraine, qui risque d’être explosif pour la CIA et la famille Biden. Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, star des réseaux sociaux et au faîte de toutes les dérives et les coups tordus du Deep State et des ténors démocrates, dont Obama, le couple Clinton et la famille Biden. Et enfin, last but not least, Robert F. Kennedy Jr., ministre de la Santé. Avocat et activiste anti-vaccin, il est connu pour ses positions radicales sur la santé publique. Son défi sera de lutter contre la malbouffe, qui frappe bon nombre d’Américains, et de les orienter vers de meilleures pratiques médicales.
Fidèle à son tempérament, Donald Trump, à peine investi, a enclenché le turbo en signant une centaine de décrets, rien que le premier jour. En matière d’immigration, il a déclaré l’état d’urgence à la frontière avec le Mexique, annonçant la reprise de la construction du mur frontalier et la fin du droit du sol pour les enfants de clandestins. Il a également qualifié l’immigration illégale d’urgence nationale, ce qui inclut l’envoi de troupes fédérales à la frontière sud et la reprise du programme « Remain in Mexico »5 pour les demandeurs d’asile.
À fond les manettes !
Sur le plan de l’environnement, Trump a signé des décrets pour sortir les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, indiquant ainsi une volonté de revenir sur les politiques environnementales de l’administration précédente en favorisant la production d’hydrocarbures.
Dans sa lutte contre les délires wokistes, Il a annoncé des politiques visant à reconnaître uniquement deux genres, homme et femme, et à exclure les personnes transgenres de l’armée.
Coup de semonce, il a également annoncé le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), coupant l’herbe sous le pied aux vaccinalistes, comme Bill Gates.
Enfin, il a immédiatement gracié environ 1.500 émeutiers du Capitole, marquant ainsi une démarche de pardon pour les événements du 6 janvier 2021.
Évidemment, c’est sur le plan économique que le président est attendu au tournant. Durant sa campagne, il a tambouriné son souhait d’imposer des droits de douane conséquents pour protéger les travailleurs et les familles américaines. Cependant, il faut rester prudent. Rien ne dit que Trump va appliquer tel quel son projet. Cela veut juste dire en fait qu’un round de négociations se profile à l’horizon avec les principaux partenaires commerciaux des États-Unis.
S’il devait procéder à une augmentation des droits de douane, il sait qu’en conséquence les importateurs relèveraient automatiquement le prix de vente de leurs produits, ce qui aurait pour résultat une aggravation de l’inflation qui toucherait directement le portefeuille des consommateurs américains. Or, après 30 ans de désindustrialisation, la part des importations dépasse les exportations de 63.5%. Le déficit commercial était d’environ 1,311 milliard de dollars en 2023. Même si Trump veut rééquilibrer la balance commerciale et favoriser le « made in USA », cela ne va pas se faire en un claquement de doigt. Son mandat de 4 ans paraît extrêmement court pour obtenir des résultats probants.
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois
Le milliardaire new-yorkais retrouve un pays en déglingue dont les déficits continuent à se creuser. Les États-Unis fonctionnent réellement sur la dette6 depuis déjà pas mal d’années, et uniquement sur celle-ci. C’est-à-dire qu’il n’y a plus vraiment de croissance. Lorsqu’on observe les marchés financiers, l’image de l’économie américaine semble pourtant florissante. Les indices US comme le S&P 5007 semblent surfer sur les crêtes. Mais en réalité, le S&P est uniquement tiré vers le haut par sept valeurs, les fameuses « Magnificent Seven »8. La planche à billets de la FED9 a visiblement été totalement aspirée par Wall Street plutôt que par « Main Street »10.
Le taux d’emploi aux USA s’apparente lui aussi à un miroir aux alouettes. Si on nous présente généralement dans les médias un chômage autour des 4%, en réalité il est plus proche des 10%. Il faut savoir en effet que dans le pays de l’Oncle Sam, les embauches sont calculées sur base d’un sondage téléphonique aux entreprises, corrigé par un indice qui date de l’ère de Ronald Reagan11. Autant dire que cela ressemble plus à une estimation au doigt mouillé qu’à une évaluation rigoureuse et contrôlée. Ce qui pour un grand pays civilisé peut apparaître plutôt cocasse, à l’image du système électoral abscons et sujet à manipulations diverses.
Rendre aux États-Unis leur efficacité
Le chantier pour remettre les États-Unis d’aplomb est immense, Trump et son équipe en sont bien conscients. Il s’est entouré de conseillers compétents dont de nombreux hommes d’affaires qui maîtrisent très bien la science économique et la gestion d’actifs. La question de la dette va être au centre des préoccupations. En effet, elle a pratiquement doublé en moins de 10 ans et nous sommes aujourd’hui avec une dette qui est à 120% du PIB, ce qui n’est pas tenable. Bien sûr, les Américains pourraient s’inspirer des Européens en augmentant les impôts. Ce qui a deux conséquences. D’une part, un appauvrissement des classes moyennes, et d’autre part, un État qui grossit, devient de plus en plus tentaculaire, exige toujours plus de moyens, mais reste toujours aussi incompétent. On le voit bien en Europe, cette solution ne fonctionne pas.
L’administration Trump a décidé de s’y prendre autrement, par une réduction massive des dépenses publiques, à l’instar de ce qu’a fait Javier Milei12 en Argentine. Le nom DOGE, inspiré de la célèbre cryptomonnaie préférée de Musk, a été officialisé par le président. Il a signé lundi dernier un décret officiel portant sur la création du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE). Ce département prévoit de mettre en place une réforme du budget national, à savoir traquer et couper le robinet des dépenses inutiles de l’État fédéral. Musk souhaite réduire la dépense publique fédérale de 2.000 milliards de dollars, soit une baisse de 30% par rapport au total de l’exercice budgétaire 2024.
C’est une véritable purge du parasitisme et une destruction du mille-feuille administratif qui se prépare. Le DOGE va s’immiscer dans les tréfonds de l’État profond et le dégraisser de milliers de postes administratifs occupés par des fonctionnaires, parfois grassement payés, mais dont l’emploi du temps est inversement proportionnel au salaire. Un nombre important d’agences et de départements issus de l’agenda idéologique des démocrates, concernant l’alarmisme climatique ou les dérives sociétales, vont aussi tomber dans les oubliettes de l’histoire.
Le Pentagone sera aussi sur la sellette, cet État dans l’État dont le budget annuel est de 800 milliards de dollars. L’armée américaine est devenue une gigantesque administration qui emploie environ 23.000 fonctionnaires, dont environ 17.000 civils et 6.000 officiers militaires. Bon nombre de ces derniers ne sont même plus sur le terrain, puisqu’aujourd’hui, les conflits armés se déroulent par « proxies » interposés. Cependant, on dénombre encore 750 bases militaires dans plus de 80 pays à travers le monde. Des bases au milieu desquelles trône souvent un Burger King. Tout un symbole.
Les fast-foods sont justement au centre de cette « american way of life », qui aujourd’hui, est très éloignée de l’image séduisante des fifties véhiculée par le cinéma et les séries tv. Les instantanés qui nous viennent des États-Unis nous montrent plus souvent des personnes obèses que des athlètes sveltes et élancés. Il y a aussi, hélas, ces vidéos tournées dans les rues de Philadelphie, de Los Angeles ou d’autres mégapoles américaines, où l’on découvre de pauvres hères se déplaçant péniblement comme des zombies, shootés à la xylazine13.
Bernard Van Damme,