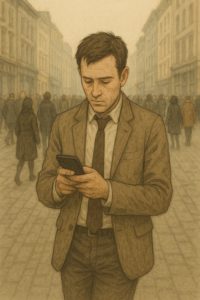Un leadership en mauvaise santé
Trump veut que l’Amérique reprenne son rôle dans les affaires internationales et redevienne réellement le leader. Mais vous ne pouvez pas redevenir le leader mondial si votre population est malade. Robert Francis Kennedy Jr., son futur ministre de la Santé, soulève justement la problématique globale de la mauvaise santé physique et psychologique de la population. Le programme volontariste qu’il compte mettre sur pied, dès que sa nomination sera confirmée par le Sénat, dépasse de loin son département. Il aura une incidence non négligeable au niveau économique et social.
De RFK junior dépend le volet le plus social et humain du projet MAGA (Make America Great Again). C’est la face la plus cachée et dissimulée par les médias dominants. La détermination sincère, philanthropique de Donald Trump d’aider son peuple à s’en sortir dévoile un aspect de son caractère qu’ont parfaitement saisi ces immenses foules venues assister à ses multiples meetings aux quatre coins du pays. Depuis 2016 s’est créée une alchimie étonnante entre ce milliardaire flamboyant et le petit peuple américain. Le contraste est total avec les élus démocrates méprisants et hautains, qui préfèrent les cénacles de l’intelligentsia du Nord-Est ou les sit-in écolo-bobos des campus californiens. Ceux qui chaque jour courent d’un boulot à l’autre pour nouer les deux bouts, ceux qui multiplient les bullshit jobs pour Uber ou Amazon, ceux qui tiennent en survie leur hardware sur Main street dans une petite ville du Midwest, ceux qui parcourent la Route 66 au volant de leur truck, etc. Toutes ces humanités qui font l’Amérique de 2025 ont compris que leur destin était lié à ce « dur à cuire », qui a connu l’échec, la faillite, qui s’est relevé, qui a construit un empire dans l’immobilier et dans d’autres secteurs et qui durant ces dix dernières années de politique active a subi les pires attaques et vilenies de ses opposants, tant du clan démocrate que de son propre camp républicain, essuyant au passage un « bashing » constant et disproportionné des médias, comme jamais aucun autre homme politique n’en a connu.
L’économie, c’est de l’énergie transformée
Comme se plaît à le rappeler régulièrement l’économiste et financier français Charles Gave1, l’économie, c’est de l’énergie transformée. L’importance du secteur énergétique est donc cruciale pour relancer ce grand pays de pionniers. Conforme à son approche de bon sens en matière d’environnement, Donald Trump a rejeté le programme radical des alarmistes du réchauffement climatique, défendu par son prédécesseur. Il a levé les restrictions de ce dernier sur le forage offshore et le développement des terres fédérales. L’initiative vise à stimuler la production américaine de combustibles fossiles et à inverser les efforts des démocrates visant au développement des voitures électriques. Ce qui au passage pourrait passer pour une anicroche envers son « colistier » Elon Musk, patron de l’emblématique firme Tesla. Mais la riposte peut aussi davantage s’adresser aux concurrents, notamment chinois, laissant la firme américaine prospérer sans autre challenger.
Le slogan « Drill, Baby, drill » va donc être appliqué avec célérité, notamment par l’entremise de Chris Wright, son ministre de l’Énergie, patron de la société de services pétroliers Liberty Energy. L’objectif est d’offrir aux citoyens américains un prix à la pompe moins onéreux qu’actuellement. Cependant, Trump devra tenir compte aussi des fluctuations mondiales et de l’attitude des pays de l’OPEP+. Ses talents de négociateur devront être au summum de son « Art of the Deal ».
La politique énergétique de Trump pourrait être utilisée comme levier dans les négociations commerciales, notamment avec l’Europe, en menaçant d’imposer des taxes douanières si celle-ci n’augmente pas ses achats de gaz naturel liquéfié (GNL) américain. Ce n’est pas le seul défi auquel l’Europe sera confrontée. La politique énergétique de Trump, notamment son investissement massif dans le nucléaire et dans l’IA, risque également de creuser un écart entre le nouveau et le vieux continent, ce dernier semblant incapable de suivre un tel niveau d’investissement, ce qui soulève des questions sur la souveraineté énergétique et technologique européenne.
Entre le 5 novembre 2024, jour de l’élection victorieuse de Trump et le 20 janvier 2025, jour de son investiture, nombreux ont été les grands patrons des sociétés informatiques à faire le pèlerinage à Mar-a-Lago, son domicile en Floride, pour défendre leurs causes relatives aux besoins énergétiques des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle (IA). La construction de Data Centers et d’infrastructures de cloud computing nécessite une énergie stable et abondante, que seul le nucléaire peut fournir. Un intérêt croissant est remarqué pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, notamment des petits réacteurs modulaires (SMR) qui pourraient fournir de l’énergie de manière plus flexible et localisée aux installations technologiques.
L’argument principal pour l’utilisation de l’énergie nucléaire est sa capacité à fournir une source d’énergie sûre, stable et à faible émission de carbone comparée aux combustibles fossiles, ce qui est essentiel pour les opérations continues des centres de données et des infrastructures d’IA. Mais Trump y voit aussi deux arguments pour mettre en avant les bénéfices économiques de ce plan. Ils affirment que des investissements massifs dans le nucléaire créeront des emplois et stimuleront l’économie locale. D’autre part, la promotion de l’énergie nucléaire peut également être vue sous l’angle de la sécurité nationale et de la compétitivité technologique face à des pays comme la Chine, en gardant la technologie et l’innovation aux États-Unis.
Trump contre le reste du monde
Nous terminerons ce tour d’horizon sur la nouvelle présidence de Donald Trump par sa politique étrangère. Durant ce second mandat, il est probable que sa ligne politique se caractérisera par plusieurs orientations principales qui reflètent sa philosophie « America First » et son approche souvent unilatérale des relations internationales.
Il paraît évident que Trump mettra l’accent sur les intérêts nationaux américains avant toute considération internationale. Cette approche se traduira par une réduction des engagements multilatéraux et un scepticisme envers les alliances traditionnelles qui ne servent pas directement les intérêts des États-Unis. On peut s’attendre au désengagement des États-Unis de certains conflits et à l’allégement de la présence militaire à l’étranger, notamment en Europe et au Moyen-Orient.
On voit déjà en quelques semaines que Trump favorise les accords commerciaux et diplomatiques bilatéraux plutôt que les traités multilatéraux, permettant ainsi une plus grande flexibilité et négociation directe avec les leaders locaux, comme Giorgia Meloni qui négocie avec Elon Musk un contrat de sécurité de 1,5 milliard €, au nez et à la barbe de l’Union européenne.
Corollaire à ce bilatéralisme, Trump va retirer les États-Unis de plusieurs accords internationaux, y compris l’accord de Paris sur le climat ou le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF). Il a menacé aussi de quitter d’autres comme l’OTAN, s’il n’y a pas une répartition plus équitable des coûts. La stratégie vis-à-vis de l’Europe est de faire monter les enjeux et d’imposer une contribution de 5% aux États membres, sachant pertinemment bien que ceux-ci seront dans l’incapacité d’y répondre, ces pays étant plongés dans des déficits structurels importants. À l’instar de la politique de Ronald Reagan dans les années 1980, qui, en lançant la « guerre des étoiles »2, poussa l’URSS dans sa chute et sa disparition définitive. Le coup de force de Trump risque d’entraîner le démantèlement de l’OTAN et en conséquence de l’Union européenne.
La diplomatie trumpienne n’a pas attendu le 20 janvier pour opérer tous azimuts. Des contacts ont été révélés tant avec Vladimir Poutine qu’avec Xi Jinping. Il est incontestable, malgré des enjeux géostratégiques qui peuvent être antagonistes, que les trois leaders partagent des conceptions communes sur la souveraineté des États et la primauté des intérêts nationaux sur les concepts globalistes. La volonté est partagée d’atténuer les conflits et de recourir à des relations diplomatiques équilibrées.
Donald Trump espère négocier la fin de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Il sait que la partie est perdue pour l’OTAN et que l’Ukraine ne récupérera jamais les territoires regagnés par les Russes. Mais il devra faire preuve de beaucoup de doigté pour sortir du piège ukrainien, sans que cela apparaisse comme un nouveau Vietnam ou comme la fuite sans gloire d’Afghanistan de Biden. Il devra aussi gérer la fin du régime de Zelensky et négocier avec les firmes américaines qui comme BlackRock avaient fait de ce pays une sorte de condominium privé.
Le processus de paix au Proche et Moyen-Orient, qui avait déjà commencé sous sa précédente mandature avec les accords d’Abraham3, va se poursuivre. Même si l’État profond, dans sa version « Pentagone », a opéré sa dernière tentative de déstabilisation en renversant le président Bachar el-Assad, qui a trouvé refuge en Russie, et en installant au pouvoir à Damas Ahmed al-Charaa, le djihadiste passé par Al-Qaïda puis l’État islamique d’Irak, avant de fonder le Front al-Nosra, puis Hayat Tahrir al-Cham (HTC), qu’il dirige toujours. Devenu soudainement « politiquement correct » après son adoubement par les puissances occidentales, son islamisme conserve cependant toute sa radicalité, malgré le costume cravate revêtu. Il suffit pour s’en convaincre de constater le traitement qu’a subi la ministre des Affaires étrangères allemandes, la très verte Annalena Baerbock, privée de serrage de mains et dont la photo officielle de la rencontre a été floutée.
Lors de son audition au Sénat pour sa nomination au poste de directrice nationale du renseignement, Tulsi Gabbard a rappelé le soutien financier et armé de plusieurs groupes djihadistes islamistes par les administrations Obama et Biden4. L’équipe DOGE a découvert, entre autres, que les responsables de l’approbation des paiements au Trésor avaient pour instruction de toujours approuver les paiements, même ceux destinés à des groupes connus pour être frauduleux ou terroristes5. Il va s’en dire que Trump va opérer un retournement complet à 180° et que l’intérim d’al-Charaa à la présidence syrienne sera de courte durée.
Le cessez-le-feu à Gaza est à mettre aussi au crédit de l’équipe Trump. Un haut responsable du Hamas, Basem Naim, attribue à l’envoyé de Trump, Steve Witkoff, le mérite d’avoir fait pression sur Israël pour qu’il signe un accord de cessez-le-feu de six semaines6.
En termes de conclusion
Même s’il ne peut évidemment pas l’avouer à son peuple, Donald Trump sait pertinemment que son pays est en mauvaise posture, tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Vladimir Poutine le sait aussi. Contrairement au président américain, il a le temps pour lui. C’est bien pour cela que tout en avançant la carte BRICS+, il modère ses propos et conseille à ses alliés de ne pas attaquer le dollar frontalement. Pour sauver ce qui peut être sauvé, Trump doit impérativement désengager les États-Unis sur l’ensemble de la planète. L’endettement massif est un collet autour de son cou. Sur le plan intérieur, il doit imposer une purge massive à l’État, en supprimant les agences et les programmes gouvernementaux inutiles. Il doit aussi juguler l’immigration massive sur sa frontière sud avec le Mexique. Les droits de douane qu’il veut imposer à son voisin doivent uniquement se comprendre dans une perspective de négociations et de forcer ce dernier à adopter un comportement plus réactif. L’enjeu est majeur. Il en va de la sécurité nationale, car le pays est confronté aux trafics de drogue, à la contrebande et surtout au passage de personnes potentiellement dangereuses.
L’immigration illégale aux États-Unis est souvent utilisée comme un vecteur par des organisations criminelles pour des activités lucratives et illicites. Les cartels mexicains, le MS13 salvadorien, La Tren de Aragua vénézuélienne, La Eme mexicaine, 18th Street Gang, sont présentes aux États-Unis comme dans de nombreux pays d’Amérique centrale, et d’autres organisations criminelles opèrent sur l’ensemble du territoire étasunien. Ils sont impliqués dans le trafic de drogue, le trafic humain, les enlèvements, les extorsions et la pédocriminalité. Plus de 300.000 enfants de migrants ont disparu sous l’administration Biden7.
Même si l’immigration peut contribuer à l’économie via les impôts et la consommation, le coût net de l’immigration pour les services publics est particulièrement lourd, surtout dans les premières années d’arrivée des migrants. Et comme dans tous les pays du monde, l’offre accrue de main-d’œuvre peut faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail des salariés locaux. C’est l’éternelle variable d’ajustement sur l’emploi.
Mais le véritable défi auquel sera confronté Trump durant ces quatre prochaines années sera incontestablement la création d’emplois qui pourraient provenir du redéploiement industriel. Pour ce faire, Trump aura besoin davantage de s’appuyer sur un capitalisme entrepreneurial, plutôt que sur un capitalisme financier. Ce n’est pas étonnant qu’Elon Musk ait rejoint l’équipe de Trump, lui qui a basé sa fortune sur l’entrepreneuriat, c’est-à-dire l’économie réelle. C’est la production de richesse réelle qui créera les emplois de demain, pas la spéculation financière. Sans renoncer au progrès technique, il devra trouver un équilibre délicat en tenant compte également des rapports de force et de la concurrence internationale. C’est aussi là que se situe l’enjeu sanitaire, auquel fera face RFK jr. Remettre d’aplomb une Amérique trop bedonnante, junkie, mal dans sa peau, plombée par le doute et le mal-être.
Quatre ans, cela paraît bien court pour résoudre tous ces problèmes. Peut-être pourra-t-il inverser juste la tendance et transmettre le flambeau à son vice-président Vance ou à un autre. Malgré son volontarisme, son punch, Trump est un homme âgé de 78 ans. Un âge où beaucoup sont déjà installés depuis longtemps en retraite, s’ils sont toujours en vie.
Le Trumpisme dépasse probablement Donald Trump. C’est peut-être un mouvement historique objectif, qui se développe et plante ses graines dans un monde occidental particulièrement vulnérable, chahuté, en remise en question. C’est une transformation identitaire dont il faut prendre compte, qui laissera une trace dans l’histoire.
Bernard Van Damme